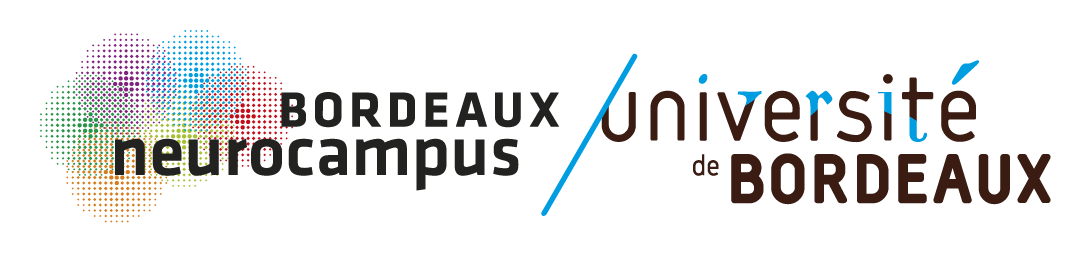Women’s voices: Olga Barba Vila
 Ce mois-ci, dans la rubrique Women’s voices (« Voix de femmes »), Sara Carracedo a rencontré Olga Barba Vila, doctorante à l’IINS et membre active du Comité Parité et inclusion de Neurocampus (NeuroPIC). Dans cet entretien, elle revient sur son parcours universitaire et évoque les défis et les espoirs de parvenir à l’égalité des sexes dans les sciences en Europe.
Ce mois-ci, dans la rubrique Women’s voices (« Voix de femmes »), Sara Carracedo a rencontré Olga Barba Vila, doctorante à l’IINS et membre active du Comité Parité et inclusion de Neurocampus (NeuroPIC). Dans cet entretien, elle revient sur son parcours universitaire et évoque les défis et les espoirs de parvenir à l’égalité des sexes dans les sciences en Europe.
Sara Carracedo : Pourriez-vous vous présenter et donner un bref aperçu de votre parcours universitaire ?
Olga Barba : Je viens d’un petit village au cœur de la Catalogne, en Espagne. Depuis mon plus jeune âge, je suis passionnée par les sciences, ce qui m’a amenée à poursuivre des études en sciences biomédicales à l’université autonome de Barcelone (UAB). C’est à cette époque que j’ai découvert ma véritable vocation pour la recherche en neurosciences, ce qui s’est confirmé lors d’un stage au sein du groupe de neuroplasticité et de régénération de l’Institut de neurosciences de l’UAB.
Pour me spécialiser davantage, j’ai déménagé en France pour suivre le Master international de neurosciences de Bordeaux (NeuroBIM). J’y ai développé un intérêt croissant pour les neurosciences des circuits et j’ai eu l’occasion d’effectuer deux stages dans des laboratoires en France et en Suède. Ces expériences ont renforcé mon intérêt pour les neurosciences systémiques, en particulier pour la compréhension de la manière dont les circuits neuronaux traitent des informations complexes. Cela m’a conduit à commencer mon doctorat en 2022 sous la direction de Mario Carta dans l’équipe « Synapses et circuits neuronaux dans le comportement » à l’Institut interdisciplinaire des neurosciences (IINS).
Pourriez-vous nous en dire plus sur vos recherches actuelles ?
Je suis actuellement en troisième année de doctorat et je me concentre sur la manière dont le cortex encode les informations gustatives. Le cortex gustatif (CG) permet aux animaux d’identifier l’identité de la nourriture et sa valeur hédonique – c’est-à-dire si un aliment est agréable ou pas, par exemple palatable (tel le saccharose) ou aversif (tel l’acide citrique), ce qui est crucial pour éviter les poisons et réguler les comportements alimentaires. Malgré leur importance, les circuits neuronaux du cortex gustatif ne sont pas aussi bien compris que ceux d’autres systèmes sensoriels, tels que le toucher ou la vision.
Dans le cadre de mon projet de doctorat, j’utilise une combinaison d’électrophysiologie ex vivo, d’optogénétique et de rapporteurs d’activité chez la souris pour explorer la manière dont le CG reçoit et intègre les informations. Plus précisément, j’étudie les entrées synaptiques que le CG reçoit du thalamus gustatif (VPMpc), qui fournit des informations sur l’identité des aliments, et de l’amygdale (BLA), qui transmet la valeur hédonique de ces aliments. Mon objectif est de découvrir comment ces entrées sont traitées au niveau synaptique et au niveau des circuits dans les neurones pyramidaux de la couche 5, qui sont les principaux neurones de sortie du cortex et qui sont idéalement placés pour intégrer les informations gustatives.
Quelles ont été les réalisations notables au cours de votre doctorat ?
Au cours de mon doctorat, j’ai franchi plusieurs étapes clés. Très tôt, j’ai obtenu une bourse de doctorat du Bordeaux Neurocampus Graduate Program, ce qui m’a permis de poursuivre mon doctorat avec l’équipe que j’avais l’intention de rejoindre.
J’ai été co-autrice d’une publication dans le Journal of Neuroscience, où nous avons discuté de la prédominance d’une équipe de recherche dans le domaine du cortex gustatif, qui reste peu étudié. Au cours de mon doctorat, j’ai eu la chance de présenter mes travaux lors de plusieurs grandes conférences nationales et internationales, notamment à NeuroFrance à Lyon en 2023 et au Forum européen de la FENS à Vienne en 2024.
Tout au long de mon doctorat, j’ai également appris plusieurs techniques difficiles, telles que l’électrophysiologie par patch clamp, qui ont été essentielles pour ma recherche. En outre, j’ai eu l’expérience gratifiante de superviser plusieurs étudiants, et les guider a été l’un des points forts de mon parcours doctoral.
Vous faites partie du Comité Parité et inclusion du Neurocampus, qu’est-ce qui vous a poussé à rejoindre ce groupe ? Quelles sont les initiatives de ce comité que vous jugez particulièrement importantes ?
Les statistiques alarmantes qui mettent en évidence l’inacceptable inégalité des sexes dans les sciences, en particulier au Neurocampus de Bordeaux, m’ont profondément préoccupée et m’ont laissé un sentiment d’impuissance. Par exemple, l’enquête 2022 sur l’égalité des sexes menée à Bordeaux Neurocampus par le Comité a révélé que les femmes ne représentent que 38% des jeunes chercheurs titulaires et seulement 25% des chercheurs confirmés. De plus, 79% des 72 responsables de 54 équipes de recherche étaient alors des hommes. Cette préoccupation m’a poussée à rejoindre le NeuroPIC, car il offrait une opportunité de contribuer au changement, même si ce n’est qu’à petite échelle et localement.
Je trouve toutes les initiatives et tous les objectifs du NeuroPIC très pertinents, car ils s’attaquent à l’inégalité entre les hommes et les femmes à de multiples niveaux. Ces actions comprennent, entre autres, le suivi de l’état actuel de l’inégalité et de son évolution dans le temps, l’organisation d’événements, la formation et le mentorat afin d’autonomiser les chercheuses et de sensibiliser la communauté scientifique.
En tant que chercheuse en début de carrière ayant travaillé dans des laboratoires de différents pays d’Europe, comment voyez-vous la situation internationale des femmes dans les sciences ?
Comme beaucoup d’autres aspects sociologiques de la vie, il existe des différences notables dans le rôle des femmes dans la science selon les pays. L’un des aspects que j’ai le plus apprécié dans mon travail dans les pays d’Europe du Nord est que les inégalités entre les hommes et les femmes dans l’environnement de recherche suédois sont comparativement moins importantes, bien que toujours présentes, que celles rencontrées par les femmes travaillant en Espagne, par exemple. Malheureusement, bien que je n’en aie pas fait l’expérience moi-même, l’écart entre les hommes et les femmes est encore plus prononcé dans les pays moins développés, où les opportunités offertes aux femmes sont souvent limitées à des stades encore plus précoces de leur carrière.
Quels conseils donneriez-vous aux jeunes femmes qui souhaitent s’inscrire à un programme de doctorat ?
Je leur conseillerais de garder l’espoir que le système profondément enraciné qui permet l’inégalité entre les hommes et les femmes finira par s’estomper. Je les encourage à défendre leurs droits et ce qu’elles méritent, et si elles trouvent cela difficile, à chercher de l’aide pour le faire.
Je veux qu’elles se souviennent que les sentiments d’inadéquation ou de doute qu’elles peuvent éprouver au cours de leur carrière universitaire reflètent rarement leurs véritables capacités. Au contraire, ces sentiments sont généralement le résultat d’un système biaisé, tant sur le plan social qu’institutionnel. Plutôt que de remettre en question leur valeur, ils devraient se concentrer sur leurs points forts et rechercher des mentors et des réseaux qui les soutiennent. Et si elles en ont la force, je les encourage à se joindre à nous pour aller vers un monde académique libéré des biais de genre !
A propos de Women’s Voices
Women’s Voices est une interview publiée dans Brainstorm et sur le site web de Neurocampus, créée en partenariat avec le Neurocampus Parity and Inclusion Committee (NeuroPIC), groupe local engagé dans la promotion de l’égalité et l’organisation d’actions visant à combler le fossé entre les femmes et les hommes dans le monde universitaire. L’objectif de cette section est d’accroître la visibilité des chercheuses en début de carrière au Neurocampus de l’Université de Bordeaux. Grâce à ces interviews, nous souhaitons non seulement mettre en lumière leurs réalisations, mais aussi servir d’inspiration à notre communauté scientifique et à d’autres femmes scientifiques.
Mise à jour: 24/06/25