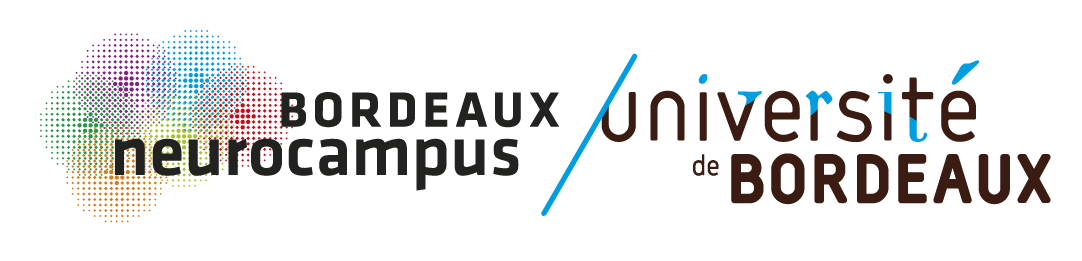Lieu : BBS
Soutenance en français
 Flore Marchaland
Flore Marchaland
Équipe : Nutrimind (Layé ; Fioramonti)
NutriNeuro
Titre
Rôle mécanistique des acides gras polyinsaturés dans le développement cérébral et la trajectoire cognitive
Résumé
Les acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 et n-6 sont essentiels chez les mammifères, qui ne peuvent les synthétiser de novo et dépendent de leur apport par l’alimentation. Une fois consommés, les AGPI s’incorporent dans les membranes cellulaires où ils jouent un rôle structurel majeur. Parmi eux, l’acide docosahexaénoïque (DHA, n-3) et l’acide arachidonique (ARA, n-6) sont des AGPI à longue chaîne (AGPI-LC) particulièrement enrichis dans le cerveau. Ils dérivent respectivement du métabolisme de l’acide α-linolénique (ALA, n-3) et de l’acide linoléique (LA, n-6), leurs précurseurs issus d’aliments d’origine végétale. Les AGPI-LC peuvent également être apportés directement par des aliments d’origine animale, principalement marins pour les n-3, et terrestres pour les n-6. Les AGPI-LC s’accumulent dans le cerveau pendant la période périnatale, au cours de laquelle ils sont transférés de la mère à l’enfant par le placenta puis par le lait maternel. Ainsi, l’apport en AGPI-LC chez l’enfant dépend fortement des apports alimentaires maternels en AGPI. Or, depuis la fin du XXe siècle, les évolutions du régime alimentaire ont conduit à une consommation accrue des AGPI n-6 en parallèle d’une réduction de celle des AGPI n-3. Des études épidémiologiques et cliniques ont mis en évidence une corrélation entre l’apport alimentaire maternel en AGPI n-3 et les performances cognitives de l’enfant. Par ailleurs, des études expérimentales chez le rongeur ont montré qu’une carence périnatale en AGPI n-3 altère les fonctions cognitives ainsi que la morphologie et la fonction neuronale chez les descendants mâles. Toutefois, les mécanismes sous-jacents ainsi que les différences selon le sexe restent peu connus.
Dans ce contexte, l’objectif principal de ma thèse a été d’étudier les mécanismes cellulaires et moléculaires impliqués dans les effets comportementaux et neurobiologiques induits par une déficience périnatale en AGPI n-3 chez les souriceaux mâles et femelles. J’ai également exploré si le maintien des AGPI n-3, grâce à une approche génétique innovante, pouvait prévenir ces altérations.
Les résultats obtenus indiquent que la carence périnatale en AGPI n-3 affecte, dans certains cas de manière différentielle selon le sexe, 1) les profils cérébraux en AGPI et leurs dérivés oxygénés (oxylipines) ; 2) la trajectoire de développement physique et moteur ; 3) la mémoire spatiale ; et 4) la plasticité synaptique à long terme dans l’hippocampe. Le maintien génétique des AGPI chez la descendance exposée à cette carence périnatale en AGPI n-3 permet 1) de prévenir les altérations de la mémoire spatiale et de la plasticité synaptique à long terme dans l’hippocampe ; 2) de densifier les synapses matures, en particulier les synapses glutamatergiques, dans l’hippocampe ; 3) de promouvoir une signature transcriptionnelle associée à la maturation des synapses et des réseaux neuronaux ; 4) de générer un profil cérébral en oxylipines unique et divergent selon le sexe. En revanche, la modulation génétique de la synthèse des AGPI spécifiquement dans les neurones CaMKII, principalement glutamatergiques, ne suffit pas à prévenir les altérations du profil en AGPI des synaptosomes de l’hippocampe ni les déficits mnésiques induits par une déficience périnatale en AGPI n-3. Enfin, ce travail montre également que la carence périnatale en AGPI n-3 altère la signature transcriptomique des microglies de l’hippocampe uniquement à partir de trois semaines post-natales, sans effet significatif observé plus tôt dans le développement, et ce de manière différentielle selon le sexe.
En somme, mon travail de thèse a mis en lumière des mécanismes par lesquels la carence périnatale en AGPI n-3 altère le développement cérébral et la cognition, en perturbant aux niveaux cellulaire et moléculaire la maturation synaptique et celle des réseaux neuronaux de l’hippocampe.
Mots clés : Développement, Comportement, Nutrition, Microglie, Synapse
Publication
Di Miceli, M., Rossitto, M., Martinat, M., Marchaland, F., Kharbouche, S., Graland, M., … & Layé, S. (2024). Modified neuroimmune processes and emotional behaviour in weaned and late adolescent male and female mice born via caesarean section. Scientific Reports, 14(1), 29807.
Jury
- Mme Sophie LAYÉ, NutriNeuro, INRAE UMR 1286, Université de Bordeaux, Directrice de thèse
- Mme Pascale CHAVIS, Directrice de recherche, Ins3tut de Neurobiologie de la Méditerranée (INMED), INSERM UMR 1249, Université Aix-Marseille, Rapporteure
- Mr Pierre GRESSENS, Professeur, Neurodiderot, INSERM UMR 1141, Université Paris Diderot, Rapporteur
- Mme Émilie PACARY, Chargée de recherche, Neurocentre Magendie, INSERM UMR 1215, Université de Bordeaux, Examinatrice
- Mme Daniela COTA, Directrice de recherche, Neurocentre Magendie, INSERM UMR 1215, Université de Bordeaux, Examinatrice
- Mr Christoph RUMMEL, Professeur, Ins3tut de physiologie et biochimie vétérinaires, Université Justus Liebig de Giessen (ALLEMAGNE), Examinateur
Membres invités :
- Mr Richard BAZINET, Professeur, Université de Toronto, Canada
- Mr Jean-Christophe DELPECH, Chargé de recherche, Laboratoire de Nutri3on et de Neurobiologie Intégrée (NutriNeuro), INRAE UMR 1286, Université de Bordeaux